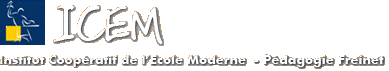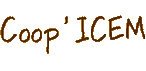Dans : Français › Principes pédagogiques ›
Mars 2011
Qu'est-ce qui en MNL donne force aux mots ou expressions, force de sens lié à leur orthographe.
Suffit-il d'avoir vu un mot plusieurs fois pour en retenir l'orthographe?
Plan
1) Il ne suffit pas de- voir plusieurs fois un mot pour le mémoriser
2) En MNL, les écrits nous concernent,
Plus le sens d'un texte nous touche, plus l'allure de certains de ses mots s'imprime dans notre mémoire.
3) En MNL chacun conquiert l'Orthographe à travers 3 grands domaines d'activité.
3.l- Messages à découvrir
3.2- Histoires de notre vie
3.3- Production d'écrits
4) La MNL rend sens, graphie, combinatoire indissociables.
5) Le réflexe MNL : "c'est comme " clé de l'élargissement des connaissances orthographiques tout au long de la vie.
Voici un exemple très récent : une petite fille, vive, intelligente, rentrant au CE1 m'écrivait début septembre 91 : "gesui a les dans un quen de vaquens dans une méson..."
Quelle que soit la méthode utilisée pour lui apprendre à lire, elle a déjà rencontré "je suis allé " et elle a sûrement copié maintes fois le mot " maison ", on le lui a dicté, etc...
Alors pourquoi cette incapacité à le mémoriser alors que cette petite fille, fine, vive est capable d'une grande attention ? Plusieurs fois, elle l'a vu sans le voir. Ce mot est resté inerte parmi les autres. Il ne s'est pas inscrit dans son histoire personnelle, il n'évoque pas une ensemble de situations dans lesquelles il aurait été repéré comme déterminant dans le sens et le souvenir qu'elle a d'un message.
De plus, il est évident qu'on lui a donné très tôt la clé de la combinatoire. Cela l'a tout naturellement conduite à un moyen de produire des mots (ce qu'elle croit être des mots), elle n'a pas de raison de les voir vraiment tels qu'ils existent : lorsqu'elle les voit, son souci est d'abord de les " bruiter " ; si elle réussit son objectif est atteint.
Ainsi, dans " maison " qu'elle écrit " méson " peu importe l'image du -ai- qui y est utilisé ; pour elle, il n'a d'importance que par ce qu'il produit comme son. Que ce soit : -é –ai –et- er –ez, ce n'est pas cela qui la marquera.
En MNL l'image des mots ou expressions prend son importance dès le départ de l'apprentissage. Pourquoi ?
D'abord à cause de la nature même des écrits qui servent de support. Ces textes n'arrivent pas dans la classe par hasard. Ils sont en rapport direct avec notre vie, leur contenu nous importe, répond à nos questions.
C'est parce qu'ils constituent des jalons dans notre histoire, dans la succession de nos projets, de nos préoccupations, de nos émotions, qu'ils s'inscrivent dans notre mémoire vécue, active, sensible, personnelle, profonde.
Les textes nous concernent parce qu'ils nous sont adressés par des gens avec lesquels on a des rapports d'intérêts, d'affection.
Ce sont les correspondants avec lesquels on réalise des projets dans le cadre de la vie coopérative.
Ces textes sont là parce qu'on en a besoin (documents, affiches, recettes...) parce qu'ils nous plaisent, nous émeuvent (poésies, chansons, contes ...) ou tout simplement parce qu'ils sont la mémoire d'événements vécus par le groupe ou par tel ou tel d'entre nous, événements qui nous ont émus, intéressés, qui ont laissé une trace dans notre souvenir.
La raison d'être de ces écrits implique que leur sens est notre seul souci et pourtant, plus le sens nous touche, plus il nous concerne et plus l'allure du mot s'imprime dans notre mémoire, la graphie et le sens ne faisant qu'un.
A cause de la nature des textes utilisés en MNL, les mots prennent une valeur très personnalisée. très affective.Cet exemple le montre :
Un jour, nous venons de recevoir des correspondants un long texte ; nous l'observons, et un petit garçon s'écrie : " ça parle du père Noël, du sapin, des cadeaux ! ".
Le texte parle aussi des fleurs, du printemps, des feuilles, de l'automne... mais il est le premier a avoir vu d'abord " le père Noël " dans ce texte.
Pas vraiment étonnant : ses parents sont " témoins de Jéhovah " et chez lui, il est hors de question de fêter Noël.
Où a-t-il auparavant capté " sapin, père Noël " ? partout où il en était question et où, à l'insu de tous, l'intensité de son intérêt, de son regard, lui ont permis de le mémoriser.
Un autre crie : " ça parle d'Anthony, c'est mon Anthony".
Cette performance là n'est possible que si l'intérêt personnel est vrai. _Associer l'image graphique du mot à son sens dans le texte se fait d'autant plus facilement qu'affectivement ce texte fait écho à des émotions, des situations, des lieux dans lesquels on se situe, dans lesquels on situe des gens que l'on connaît. Cet exemple en témoigne.
Nous étions allés passer une journée chez nos correspondants au début novembre. Deux jours plus tard, ils nous envoient une longue lettre collective. A peine la lettre affichée au tableau, plusieurs enfants crient :
"Ils nous parlent du " FRICHE "."
Je n'ai jamais vraiment su comment ils avaient trouvé, car, à cette époque de l'année, pas question de références nombreuses, pas question de déchiffrage du mot.
Ce que je sais, c'est que " Le Friche ", champ de jeux que les correspondants avaient l'habitude d'appeler comme ça, avait été le lieu du plus fort moment de la rencontre (lancer des comètes, cadeaux réalisés pour les correspondants).
II a été, le premier mot repéré dans ce long texte, il a été mémorisé sur l'instant, reconnu d'emblée et réutilisé souvent ensuite.
Dans ce cas, en effet, la recherche du sens de ce message nous place dans une relation personnelle avec l'écrit, elle nous met en situation de vraie lecture qui va faire intervenir nos priorités d'intérêts.
Les mots sur lesquels on va s'appuyer pour construire un sens vont s'inscrire dans un cheminement personnel qui met en interaction nos questions et tout ce qu'on sait déjà.
La force, la présence, l'impact, laissés en nous par certains mots sont d'autant plus forts que le sens découvert a résolu un problème que l'on se posait, qu'il a provoqué en nous une surprise, une crainte, une joie...
A cause du sens du message complet, on se souviendra dans quel contexte se trouve ce mot, et si on n'en a pas maîtrisé, mémorisé la graphie, on le situe, on sait où le retrouver lorsqu'on en a besoin. Cette aptitude là n'est possible que si les premiers contacts avec l'écrit ont répondu à l'attente de sens, et si le sens a été repéré comme imprimé à telle place dans le texte.
À ce moment là, le sens de l'expression, du mot, est perçu comme intégré à cette image graphique. Admettre dès le départ que c'est cette image qui exprime ce sens et pas une autre, c'est admettre que l'orthographe nous permet de comprendre et qu'on n'a pas d'autre solution que de s'y soumettre si on veut être compris, si on veut communiquer.
Si on a admis cette impérieuse nécessité de se conformer à la graphie existante pour être compris, nous mettons en place des tactiques d'observation rigoureuse, de mémorisation visuelle parce qu'on sait que ce dont on aura constamment besoin, c'est d'avoir en quelque sorte photographié les mots, de les avoir en mémoire.
Qu'est-ce qui, en MNL permet à chacun de conquérir l'orthographe ?
En MNL, chacun conquiert l'Orthographe à travers ces 3 grands domaines d'activité :
- Messages à découvrir.
- Histoires de, notre vie.
- Productions d'écrits.
1- Messages à découvrir
Comme je viens de le montrer, la première force de la MNL pour l'orthographe, réside dans le rapport affectif que chacun de nous a avec tels ou tels textes qui concernent la vie du groupe. Le regard particulier que certains mots ou expressions ont attiré, laisse une première trace (mémoire affective, mémoire dans le temps, les lieux, les circonstances, mémoire visuelle du mot - fugitive peut-être pour cette première rencontre -).
C'est cette trace qui permet à l'enfant de dire, face à -merci- qui apparaît dans un texte à découvrir : " là, on dirait que c'est –mer » On le dirait !, mais cela la reste à vérifier.
La comparaison rigoureuse avec le mot –mer- existant dans une histoire précédente, va venir consolider la première trace.
Cette attitude constante de vérification est déterminante pour l'orthographe et pourtant ce n'est pas le souci orthographique qui l'exige là.
C'est avant tout le besoin de se donner d'accéder au sens.
Ainsi, dans ce cas, les correspondants nous disaient : " Merci pour les algues ".
Avoir trouvé: "-mer- ci... pour les algues" sachant qu'on leur- avait envoyé un colis d'algues, c'était se donner les moyens d'une piste de sens. Certains enfants ont tout de suite dit :" Alors, c'est sûrement " merci " qu'ils nous disent ".
Ces écrits constituent un stock consulté par tous à chaque instant pour lire vu pour écrire.
C'est parce que ces histoires de vie racontent des moments qui ont été vécus par tous ou par des camarades qu'on cannait bien ; c'est parce que ces témoignages nous ont touchés que chacun aime à les relire.
On voit combien en MNL sens et orthographe sont indissociables, " merci " restera pour ces enfants là, associé à l'écriture de " mer " puisque c'est ce qui leur a permis de découvrir son sens.
Ces expressions, ces mots qui ont laissé une trace plus ou moins sûre, sont les points d'ancrage pour la construction de sens dans les textes nouveaux, inconnus.
Ainsi, de proche en proche, le savoir lire de chacun se construit en fonction de ses savoirs antérieurs et de ses rencontres et découvertes, cela se fait à son rythme.
2- Histoires _ de notre vie
Parallèlement â ces textes à découvrir, nous travaillons aussi sur des histoires de notre vie. Ces textes n'ont pas pour rôle de mettre les enfants en situation de vrais lecteurs (mettant en oeuvre tous les moyens peur en construire le sens) puisque ces textes sont les leurs. Le message est donc connu.
Alors quelle est leur utilité ?
En quoi peuvent-ils aider chacun à conquérir l'orthographe ?
D'abord, ces écrits sont ta mémoire des moments forts de la vie du groupe, moments qu'on aime à retrouver en feuilletant le recueil (livre de vie) qui les rassemble et les garde à disposition de chacun.
Comme on a peu d'effort à faire pour en mémoriser le contenu, il est plus facile de s'y repérer. Certains enfants ne peuvent, au début s'intéresser qu'à leur propre histoire.
Avoir leur nom en signature du texte est le signe qu'ils sont reconnus, qu'ils sont une partie du groupe.
Ils se complaisent à lire et à relire cette histoire puis petit à petit, celles de leurs amis ou les histoires qu'ils préfèrent.
C'est cette attitude qui leur permet de prendre leurs premiers indices. Pour que ces écrits deviennent objet d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, un certain nombre de compétences sont à développer chez les enfants.
La première et indispensable consiste à être capable de dire rigoureusement ces histoires sans omettre et sans ajouter un seul mot, car n'ayant, à ce moment, aucun moyen de vérification par le déchiffrage, il n'y a que le rythme et l'espace du texte qui permet à l'enfant de localiser l'expression ou le mot dont il a besoin.
Donc, dès qu'il est apte à détecter exactement la place de tel ou tel mot dans une histoire, il acquiert un pouvoir, une autonomie qui lui permet d'élargir tout seul ses références. C'est là, la porte ouverte à la possibilité par l'enfant de se constituer un stock très personnel.
II est donc urgent de l'en rendre capable
’est pourquoi nous proposons certains exercices d'entraînement visant cet objectif.
Mais bien évidemment, le plus efficace d'entre tous les exercices, celui qui motive réellement la nécessité de prélever tel mot plutôt que tel autre, c'est bien sûr produire de l'écrit pour communiquer vraiment et c'est bien là, la spécificité de la MNL.
3_- Productions d'écrits .
En MNL quels écrits produit-on ? D'abord des lettres à un correspondant, que l'on connait, que l'on situe dans un environnement classe et parfois même famille.
On envoie, des comptes-rendus de réalisations, de voyages, des histoires imaginaires...
Enfin tout ce qui constitue nos plaisirs, nos soucis, nos informations, nos questions... L'échange est réel.
La situation de communication est vraie.
L'organisation de ces moments d'écriture est fonction des situations qui les provoquent
mais on écrit chaque jour.
Cela peut être en :
- petit groupe : compte-rendu, inventions...
- en grand groupe : lettre collective, compte-rendu qui concerne tout le monde
- en individuel : lettre, histoire...
Mais dans tous les cas, chacun participe avec ses propres savoirs. Il les propose, cela déclenche des débats, on est d'accord ou pas.
On vérifie, chacun défend son point de vue en annonçant ses références.
On s’assure alors qu'il a raison, et pour cela, on repart aux références auxquelles il fait appel. Cela provoque une relecture des textes, une quête, un regard en recherche.
S’l a fait une erreur, on cherche pourquoi il a pu faire cette erreur, et toutes ces activités sont autant de situations de fixation de l'orthographe. Pour écrire, on énonce dans une prononciation intérieure ce que l'on souhaite exprimer.
On écrit du sens et pas du bruit.
Si c'est "Pain" ou "pin", "mer", 'mère", "maire", c'est le sens de l'histoire qui détermine l 'orthographe et tout naturellement le lieu où il va aller chercher le mot qui convient pour son sens.
Le recueil des textes connus joue le rôle de dictionnaire personnalisé (textes qu'on a explorés et histoires de vie), dans lequel les mots ont pris vie pour chacun au cours des diverses rencontres : on sait que tel mot est dans telle histoire, et que cette histoire est avant ou après telle autre.
Produire de l'écrit, produire le sens que l'on souhaite conduit à segmenter, à analyser l'écrit référence pour y puiser ce dont on a besoin. C'est manipuler la langue écrite, la faire fonctionner, l'utiliser personnellement.
Cela conduit l'enfant à porter son regard sur des mots ou expressions qu'il n'avait pas remarqués auparavant. Le besoin qu'il en a aujourd'hui l'oblige à porter son attention sur des mots qui, pour lui, jusqu'à cet instant n'avaient pas d'importance de sens.
Pour parvenir à détecter le mot recherché, l'enfant doit d'abord retrouver le texte qui le contient. Ensuite, il doit parcourir des yeux rapidement l'ensemble du texte. Cette activité qui se répète à chaque recherche est un facteur très important de familiarisation avec ces écrits. Au début, il tâtonne pour trouver et ensuite, il devient capable d'aller d'emblée où se trouve le mot.
Cette aisance est importante pour l'orthographe car elle rend facile la vérification par l'enfant lorsqu'il a un doute sur le graphie du mot.
Écrire de façon rigoureusement conforme au modèle avec le ralenti qu'impose le geste graphique, cela renforce la mémoire visuelle et y ajoute une mémoire gestuelle.
Savoir qu'on invente pas les graphies : savoir que lorsqu'on en aura besoin, il faudra avoir recours au modèle aussi longtemps qu'on ne le maîtrisera pas, incite à une certaine intensité de l'observation.
Lorsqu'on a stocké un certain nombre d'éléments relatifs à l'écrit, les remarques deviennent beaucoup plus faciles à mémoriser puisqu'elles s'accrochent à ce qu'on sait déjà.
Par exemple, il est facile de se rappeler "leçon" si je connais bien "garçon" et si j'ai mis en relation dans ma mémoire "çon" de "leçon" c'est comme celui de "garçon".
L'exploration des textes, les comparaisons incessantes entre l'écrit connu et l'écrit inconnu vont susciter des remarques, des découvertes de plus en plus, fines. "C'est comme" devient le mot magique de la MNL Les analogies, les différences s'affirment, sautent aux yeux ou aux oreilles parfois !
Des séries se constituent dans le mémoire de chacun, par exemple :
mange pin nous avons
manche pince nous partons
manteau pépin nous allons.
lapin.
J’ai chanté pour tourner à Mante
J'ai joué pour aller à la campagne.
J'ai joué pour aller à la campagne.
pour sauter à l'école
On se rend bien compte alors qu'en même temps qu'on lit qu'on produit des messages pour leur sens, on engrange de plus en plus de mots ou d'expressions, qu'on fait de plus en plus de remarques sur le fonctionnement de code.
On met en relation ce qu'on découvre aujourd'hui avec ce qu'on connaissait déjà. On en déduit des amorces de règles. C'est du travail de logique, de raisonnement.
Par exemple on avait :
- les papillons s'envolent
- les grillons chantent
Lorsqu'on est arrivé à : - les fleurs s'ouvrent, Cela a provoqué débat, réflexion.
Lorsque chacun a suffisamment de connaissances pour que naissent les classements, c'est que la découverte de la combinatoire est proche ; c'est aussi le début de la mise en évidence de phénomènes, prémisses des règles d'orthographe.
Qu’est- ce qui, en MNL, permet de rendre la maîtrise de la combinatoire indissociable de l'orthographe ?
Le regard qu'on porte sur les mots inconnus a toujours une double quête :
- quête du sens (en s'aidant du contexte, des hypothèses)
- quête de similitude par rapport aux mots déjà connus.
La quête de code n'a pour but que de mettre sur le chemin du sens.
Ainsi face à ce texte : Avec les fleurs d'Anthony On a le................. dans la classe.
Guillaume n'ayant pas pu faire d'hypothèse, s'est essayé à amorcer le mot et il a réussi à le fabriquer en entier:
pr de promenade
in de invité
et temps comme dans tempête, mais pas n’importe qu'elle tempête, celle qui a tout cassé au port de Concarneau et au centre de classe de mer où nous séjournions 8 jours plus tôt !
Pas étonnant si une orthographe " comme dans tempête " ne passe pas inaperçue ! Dans cet exemple, c'est le code qui a permis à Guillaume d'accéder au sens.
En MNL, celui qui apprend est reconnu capable de découvertes. Il sait qu'il est amené à faire appel à tout ce qu'il sait déjà,à tout ce qu'il peut émettre comme hypothèse. Il observe, il compare avec les textes connus à sa disposition.
Il met en relation tout ce qu'il connait pour aboutir au sens.
Ainsi, lorsqu'un correspondant écrit :
- " Mon copain m'a dit qu'il était allé à Paris mais ce n'est pas vrai, il dit toujours des mensonges ". Le lecteur ne connait pas mensonge. Ayant tout lu ce qui précède, il peut supposer... ce n'est pas vrai il dit toujours des : (bêtises, blagues...) Il essaie de vérifier son hypothèse à partir de ce qu'il sait.
Dans ce mot,
il voit : m - attaque qu'il connait à cause de "moi-maman-mon";
il voit "en" comme "en face-en bas-en forme;
il voit "son" qu'il connait dans "son chat". Il a trouvé "menson". Il devine "ge".
Il peut vérifier : il voit que c'est comme "mange-rouge". Il a voulu découvrir ce mot pour son sens, mais il a eu recours au code.
La manière qui lui a permis de le découvrir en faisant appel à ses connaissances, le tri, le choix qu'il a été amené à faire pour cela resteront dans sa mémoire parce que sa recherche a été intense. Il avait le désir de s'en sortir seul.
I1 connait le plaisir que procure la réussite.
Il sait que le "en" (le "mensonge" lui a fait penser au "en" de "en forme" et non à "Antonio", que le "son" n'était pas celui de "garçon" et le "ge", pas celui de "je suis".Un autre, à sa place aurait fait appel à d'autres références, à celles ancrées dans sa propre mémoire.
Ce qui est à remarquer, c'est qu'aujourd'hui, l'acquisition est double. Face au mot "mensonge" dont la lecture est maintenant devenue sûre,
- il y a perception de la signification
- il y a graphie, mise en mémoire grâce au cheminement qui a permis sa lecture.
Ce cheminement restera longtemps présent dans l'esprit de l'enfant. En même temps que la vision de mensonge, lui repasseront en mémoire très vite toutes les références personnelles acquises bien avant et auxquelles il a fait appel.
Ce savoir là, il est solide, ancré. Il s'est mis en place au cours d'un grand nombre de situations, d'expériences, de remarques. Il s'est fixé dans la mémoire avec toutes ses références orthographiques.
Ces deux exemples démontrent que lorsqu'en MNL on en est arrivé à la découverte et à la rnaîtrise de la combinatoire, on sait non seulement organiser la succession des phonèmes pour produire le "bruit du mot" mais on sait choisir les phonèmes qui sont nécessaires pour produire sa graphie conforme au français en usage.
"C'est comme"
clé de la -fixation de l'orthographe pour l'enfant en MNL, devient clé de l'élargissement de ses compétences orthographiques lorsqu'il est devenu adulte.
En effet, dès les premiers contacts avec l'écrit, la MNL, dont l'objectif est toujours le sens, permet de comprendre qu'un mot dans un contexte déclenche une image mentale qui dépend de sa graphie
Cette graphie est donc perçue comme très importante. L'exploration et la production permanentes des écrits, parce que, s'occupant du sens, vont à tout moment déboucher sur des remarques orthographiques et aboutir à des classements.
C'est grâce au "c'est comme" ou "c'est pas comme» qu'on est parvenu à la maîtrise du code.
Cela a été le moyen essentiel qui, d'emblée, permettait de trouver du sens ou de fabriquer le mot pour accéder au sens.
Cette attitude de questionnement au sujet du code devient automatisme, réflexe,
Le lecteur lit pour le sens, mais en même temps, sans s'en rendre compte, il classe les mots qu'il rencontre et qu'il n'a pas forcément l'habitude de voir.
Il les associe d'emblée aux séries existantes dans sa mémoire ou crée une nouvelle série. Il peut dire : "Hier dans telle lecture, j'ai vu ce mot, il s'écrit de telle façon."
Pourtant son esprit quêtait du sens et non du code. L'orthographe s'est fixée à son insu. Pour produire de l'écrit dont il ne connaît pas l'orthographe, il ira, comme en MNL, cherche I'orthographe juste là où elle se trouve : dictionnaire ou autres documents.
Danielle de Keyser
(Novembre 1991)
Auteur :