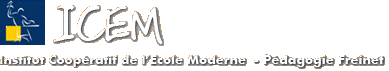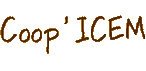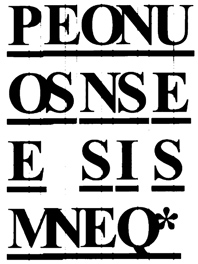| La poésie NONSENSIQUE
en classes de collège
Pour une pédagogie de l’imaginaire |
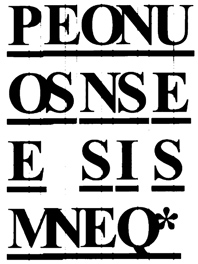 |
Aux poèmes nonsensiques sont associées
des réalisations de classes de 4ème d'un autre collège
autour du thème "Créativité et faux-semblant"
(Pour en savoir plus sur ce travail: cliquez ici!)

La poésie nonsensique se trouve déjà au Moyen âge dans des poésies fondées sur le coq à l’âne (répertorié par les rhétoriqueurs de la fin du Moyen âge et de la Renaissance) et autres procédés de la littérature carnavalesque dont l’énumération chère à Rabelais, ou encore la néologie.
L’allographie (transposition d’un texte en d’autres mots, comme en usent les charades et les rébus), l’antilogie (soit l’association de deux idées contradictoires),
la dissociation (unir un thème et son propos qui sont incompatibles, c’est-à-dire une sorte d’antilogie au niveau de la phrase),
l’effacement d’objet (un couteau sans lame dont il manque le manche),
la polyglossie, sont des procédés qui portent ou peuvent porter le texte à du non-sens. Quand on parle de poésie nonsensique, on pense immédiatement à Lewis Carroll. Ce dernier étant un logicien reconnu, il sera facile au lecteur de comprendre que derrière le non-sens se cachent des règles. Et c’est de là que je suis parti.
|
Depuis plusieurs années, je fais faire des limericks aux élèves.
Je demandais donc des poèmes de cinq vers, en multipliant l’appel aux procédés cités dans le paragraphe ci-dessus : anthologie, etc.
|
Mon modèle était le livre de E. Lear, Poèmes sans sens (Aubier-Flammarion, 1974) traduit et introduit par Henri Parisot qui est, aussi, celui qui a traduit Lewis Carroll en La Pléiade, et les pages 235 à 242 du livre de A. Duchesne et Th. Legay, Les Petits papiers, chez Magnard, de 1991.
|
| Le plaisir engendré par les poèmes obtenus, le plaisir de les dire qui traverse le niveau des élèves en français, m’a poussé à rechercher d’autres procédés similaires. C’est ainsi que j’en suis venu à la poésie nonsensique que j’écris d’un seul mot et sans trait d’union. Mais, si pour le limerick, je partais directement des écrits des élèves, pour des poèmes plus longs, j’ai ressenti le besoin de m’appuyer sur une trame formelle. Du coup, l’occasion était trop belle, j’ai décidé d’amener les élèves dans une tranche de l’histoire de la poésie qui naît en Angleterre au XIXème siècle. |
Une revue, remarquablement éditée (Plein Chant n°14 de 1983, 4euros - Plein Chant 16120 Bassac), offre justement plusieurs poèmes de William Brighty Rands (1823-1880). Moins connu que Lear ou Carroll, Brighty Rands appartenait à ce courant de poésie nonsensique qui n’est pas sans lien avec celui des nursery rhymes (Carroll suffit à le comprendre). Il publia deux recueils Lilliput Levee en 1864 et Lilliput lectures en 1871. Les poèmes rassemblés par Plein Chant sont extraits du premier recueil. |
Il me restait à trouver un dispositif pédagogique adéquat. Très vite je me suis dirigé vers une poésie collective, en me disant que la confrontation allait permettre de faire s’épanouir le rire et l’humour et motiver la recherche lexicale, syntaxique voire rhétorique par le groupe pour aller plus loin. Mais pour qu’il y ait poésie collective, il faut, bien sûr, qu’il y ait apports personnels de chaque élève. De plus, je trouve très lassant les textes collectifs -on ne sait jamais trop, au final quelle est la part des élèves, celle de l’enseignant-e, la part de chacun enfin. J’ai donc cherché une formule permettant d’allier les deux démarches d’écriture : bref, un poème collectif où chaque écrivain aurait à cœur de développer sa part de poésie de l’œuvre collective. J’ai donc adopté le dispositif suivant
L’année prochaine, je vais continuer à travailler sur la poésie nonsensique. Outre la revue Plein Chant, je vais m’appuyer sur l’ouvrage Rabutes et Clignettes : beaucoup de limericks, des comptines, de la joie et de la jubilation: «Tire Tire Pompon,/ Il faudra vingt bobines / Pour sortir de la mine / Un gros sac de charbon / Pour faire la cuisine / Avec les Aubépines / Et rentrer les moutons», soit la maxime «Le meilleur moyen de se libérer l’esprit est de s’occuper les mains»… en écrivant par exemple.
Philippe Geneste
|

|

|
|
témoignages
|
Sommaire
|
Poésie nonsensique, écriture
|